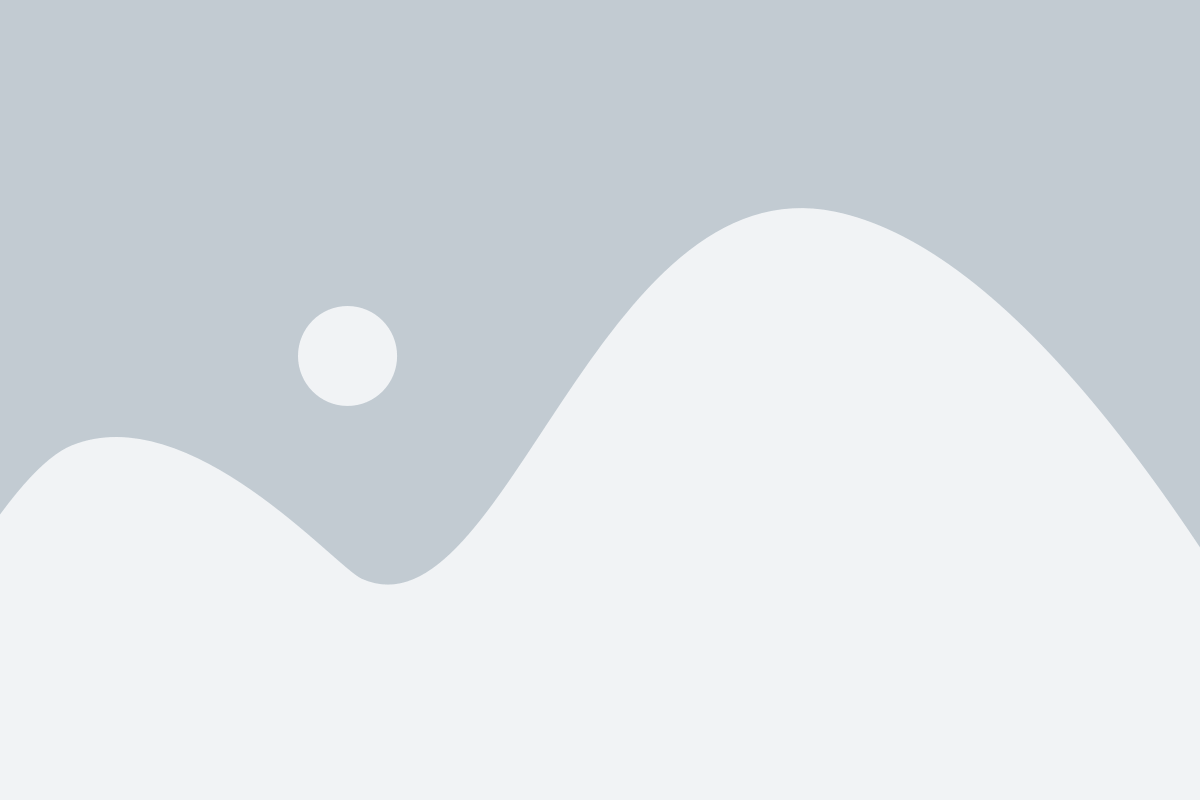Adaptation de littérature européenne, fable sociétale, fresque chevaleresque, polar transpirant, drame historique : Akira Kurosawa n’a pas réalisé Ran qu’il est déjà passé par tous les genres et toutes les époques, a livré certains des plus imposants chefs d’œuvre du cinéma nippon et a inspiré leurs propres classiques à d’autres. En 1985, le maître japonais n’a donc plus rien à prouver, malgré une traversée du désert qui aura presque duré quinze ans. Extirpé de cette mauvaise passe par ceux qu’il a bercés artistiquement – dont un George Lucas sorti du premier Star Wars et un Francis Ford Coppola loué pour Le Parrain –, Kurosawa vient de remporter la Palme d’or au Festival de Cannes quand il s’attelle à ce qui, selon ses dires, est le long-métrage qu’il préférait parmi les siens. Une œuvre à nouveau tirée d’un texte shakespearien (après Le château de l’araignée et Les salauds dorment en paix) mais cette fois jouée sans son comédien fétiche, un film réfléchissant les qualités techniques et dramatiques des précédents, un monument trônant tout en haut de sa filmographie foisonnante et emblématique.
THÉORIE DU CHAOS

La première image de Ran raconte les suivantes. Quatre cavaliers de l’époque Sengoku, aux couleurs contraires, et dont les regards ne se croisent pas, ornent le haut d’une colline. Si ces soldats-ci ne sont que de beaux figurants en costume, leur nombre et leur position annoncent la dissension sur le point d’éclater chez les protagonistes. Quelques panoramas plus tard, dans un camp non loin de là, un vieux daimyo prend la décision de céder son fief à ses trois fils, une résolution immédiatement contestée par l’un d’eux. Saburo, le trublion aussitôt renié par son père, vient pourtant de résumer l’ironie de la situation et de dénoncer celle qui anéantira son clan sur le reste du long-métrage : le paternel, tyran monté au pouvoir par la traîtrise, compte sur la loyauté de ses enfants pour faire respecter ses dernières volontés et garantir l’unité du royaume. La suite donne raison à Saburo, les héritiers œuvreront à se trucider. Ran est ainsi l’histoire d’une passation orageuse, d’un nœud idéologique autour de l’héritage, mais également une exceptionnelle et retentissante démonstration du chaos, ou comment une poignée de mots conduisent à l’anéantissement d’une dynastie. Le seigneur qui ne désirait autre chose que de confier son domaine à sa descendance, et couler des jours tranquilles, a déclenché une spirale destructrice que rien (et certainement pas les liens du sang) ne peut éteindre.
Kurosawa s’inquiète du chaos pour ce qu’il a d’exponentiel, tel un venin qui se propage dans l’organisme, un incendie qui s’étend de pièce en pièce, une boule de neige qui se change en avalanche. Après l’esclandre du haut de la montagne, l’affaire du legs déborde inévitablement du périmètre familial pour gagner les personnages secondaires, les lieutenants et les concubines, les complices et les victimes, puis enfin la nation. De l’harmonie des couleurs primaires aux flammes de l’égoïsme, de l’avidité et de la trahison, il n’y a pourtant que des mots. Le chaos est aussi révélateur, la caméra du maître s’y penche : elle s’efforce de mettre en exergue les ténèbres et lumières qui émanent du regard, dans l’agitation. Le réalisateur perpétue son illustration de l’homme en tant qu’entité pluraliste, à la nature changeante, faillible et individuelle. Le bazar monstrueux de Ran ne serait qu’un moyen de s’enfoncer davantage dans la psyché de ses personnages, caractérisés comme au théâtre – auquel Kurosawa rend hommage par la scénographie des séquences intérieures –, pittoresques, caricaturaux, mais que la dramaturgie dresse crescendo en figures de nuances. Au cœur de cet éventail de visages contrariés, le père Hidetora déchante. Il est l’instigateur involontaire de la débandade, et Kurosawa traite sa désillusion de parent, de chef et d’être humain au premier plan.
LE ROI FANTÔME

Ses premières lignes de dialogue renvoient Hidetora à sa détermination militaire. Le jeu du légendaire comédien Tatsuya Nakadai, comme l’extraordinaire maquillage qui creuse les traits de son visage, révèlent une autre facette du personnage : son âge avancé et le dépérissement qu’il implique. Kurosawa ne connaît que trop bien cet archétype, figure d’autorité sénile, variation du roi Lear dont il reproduit librement la trajectoire en mêlant le pouvoir et la vieillesse à la folie. Sur le modèle shakespearien, le réalisateur insémine le désordre à l’intérieur de son personnage, corrélant la chute de son domaine à sa diminution mentale. Le chaos auquel fait référence le titre est ainsi total, applicable aux tempêtes armées qui balayent la vallée et au chambardement psychique ayant lieu dans les crânes. Confronté à la fougue meurtrière de ses garçons, lancé dans une marche funèbre par-delà ses terres noircies, torturé par des visions sanguinolentes aux milliers de cadavres, Hidetora flanche, perdant de sa prestance au gré des campagnes fratricides, de sa noblesse quand la suie recouvrent ses draps blancs. Le daimyo se métamorphose en fantôme avant d’être mort, effigie décolorée et incapable, si dépossédé qu’il paraît ne plus appartenir à ce monde. C’est pourtant le sien qu’il visite, un lieu de violence, de conflits interminables et de destruction.
L’humanisme du cinéaste empêche Ran de n’être qu’une sinistre histoire de punition. Ce dernier distille dans le pénible voyage de son protagoniste – bazardé de château en champ de bataille – quelques éclairs de rédemption. Hidetora frôle alors les murs de ses demeures enflammées en refusant l’immondice du système criminel auquel il a vastement participé et en constatant son échec : en voulant offrir à ses fils un fief soumis par la peur, l’ex-bourreau leur a transmis les valeurs belliqueuses qui le hantent. L’épiphanie du vieillard est gratifiée de rencontres avec d’autres fantômes (l’aveugle Tsurumaru), d’autres âmes écharpées par la domination (les compagnes de ses fils), d’autres figures de démence. Les plaines verdoyantes de l’ouverture sont lentement relayées par des déserts calcinés, une sorte d’entre-deux-mondes, de purgatoire à ciel ouvert où braillent les fous. À commencer par Kyoami, le bouffon de Hidetora, qui rappelle le magnifique quiproquo de Kagemusha, l’Ombre du guerrier – où Kurosawa intervertit la place du roi et de la crapule – en soulignant, avec une grâce identique, l’absurdité des événements pendant que les fils, biberonnés par le pouvoir, le sang et la mort, vouent leurs heures à s’entre-tuer.
CADRES DIVINS

À l’exception des cavaliers perchés dans la montagne, c’est le ciel qui interpelle lors de la séquence inaugurale. Il scinde assidûment le cadre en deux. Akira Kurosawa ne l’a que rarement transcrit de la sorte, avec une telle prédominance, et ne l’a jamais autant filmé que dans Ran. Car son scénario se joue en réalité à deux niveaux : sur la terre empoisonnée des hommes et dans le ciel. Et lorsque celui-ci ne couvre pas la moitié d’un plan, accentuant la dimension apocalyptique des batailles et reconsidérant l’humain en tant que pièces infimes d’un gigantesque ensemble, le réalisateur lui cède tout l’espace. De fait, en prêtant ses focales à la représentation de la nature (une vallée verdoyante, une plaine rocailleuse, etc.), Ran renvoie le destin de ses personnages à leur insignifiance dans l’univers, trop concernés par leurs affrontements incessants pour s’affranchir du sol – ou juste y songer. Les coupes opérées par le long-métrage, passant de la désolation des hommes aux courbes des nuages, font alors figure de champs-contrechamps. Comme si les divinités scrutaient le spectacle infernal de là-haut, sans offrir la moindre réponse à ces sacrifiés du front, sans intervenir dans leur propagation du chaos. Pire : l’ultime photogramme, si éloigné de l’action que l’on ne peut en distinguer les détails mais dominé par le ciel, condamne l’humanité en se fermant par un fondu au noir, mimant l’obscurité engloutissant le monde. Le dernier signe du désintérêt du céleste, l’autre protagoniste, pour ces hommes responsables de leur propre mal.
Pour mettre au point l’imagerie dantesque de son vingt-huitième long-métrage, Kurosawa se base sur ses travaux de peintre – il aurait pensé et dessiné les images du film durant les dix années qui précèdent sa production – et sur les expérimentations techniques élaborées sur Kagemusha, induites par un passage récent à la couleur. Dans le pur prolongement de son cinéma d’esthète, Ran est un summum de cadres finement étudiés, érigé à partir d’un découpage affûté telle une lame de samouraï et d’une assimilation remarquable de la colorimétrie. Les ruées de soldats, vêtus d’armures rouge, jaune ou bleus – qui démontrent autant leur démarcation qu’elles apparaissent clairement sur les plans larges –, prennent la forme de vagues abstraites s’écrasant les unes sur les autres avant de se dissiper sur une toile terne comme la cendre. Moins extravagant que le précédent opus du maître japonais, défait de son onirisme exagéré, Ran conserve cependant ses marques de tableaux en mouvement, traduisant la beauté simple de la nature quand la caméra se pose sur les paysages radieux de la vallée japonaise, ou le vif du rouge quand celui du sang barbouille les murs. Et puis, Kurosawa imprime des plans d’ensemble dont lui seul a le secret, d’une efficacité imparable, d’une majesté stupéfiante, joignant le chaos des éléments, les couleurs primaires qui habillent la trame et l’immensité du ciel en une seule vignette.
FILM ULTIME

Au sein de la filmographie de son auteur, garnie de classiques hétéroclites mais répondant d’une logique irréductible, Ran a tout du film ultime. Un condensé de ses plus grandes œuvres, où conversent le souffle homérique des Sept Samouraïs, la poésie funeste du Château de l’araignée, le pessimisme d’Entre le ciel et l’enfer et la lucidité de Rashōmon. Un acte épique, désespéré et furieusement démesuré, permis par un budget confortable (le plus conséquent alloué à un film japonais en son temps), pour lequel Kurosawa se mue en démiurge, fait construire de véritables décors moyenâgeux et organise la création de centaines de costumes pour un même nombre de figurants à l’écran. Un projet qui lui donne l’opportunité de capturer les échauffourées les plus massives de sa carrière, exercice qu’il embrasse de toute sa technicité, de toute son intelligence de metteur en scène. Ran est aussi un moyen pour le japonais de déclamer sa trouille de l’autodestruction et de la violence, appétences humaines qui arpentent l’histoire de son pays (et son œuvre globale par ricochet), qu’il conjugue ici au passé en évoquant l’anéantissement d’un clan à l’ère féodale mais dont il saisit l’intemporalité par la justesse des mots et l’universalité de sa narration. En toute logique, Ran est également l’œuvre la plus brutale d’Akira Kurosawa, faisant appel, une fois encore, à la sécheresse de longs-métrages précédents pour échafauder un terrible théâtre de sang, relatant ni plus ni moins que la fin du monde.
La maestria dont témoigne le cinéaste, du haut de ses soixante-quinze ans, laisse à penser que Ran est un aboutissement, le film du perfectionnement, la forme finale de son art. Une œuvre parvenant à encapsuler le divin et l’enfer autour d’une histoire familiale, tissant un pont thématique et visuel entre l’intimité des mortels et le gigantesque de ce qui est éternel – deux pôles que Kurosawa n’aura cessé de chatouiller au long de son cinéma. Sa narration de trois heures de long, enjolivée par les notes du compositeur Tōru Takemitsu et les expressions sidérantes de Tatsuya Nakadai (l’acteur iconique de Hara-kiri, Les Loups et La Condition de l’Homme), semble parachever le développement de ses sujets de prédilection, proférés par une myriade de personnages nuancés, noués par leur psychologie complexe et leur rapport tragique au pouvoir. Et si Akira Kurosawa, nom parmi les plus prestigieux de l’histoire cinématographique japonaise, n’avait assurément pas besoin d’un projet supplémentaire au compteur pour attester de son importance dans le paysage culturel international, il livre avec Ran son plus prodigieux, émouvant, complet, lyrique et monumental enchaînement de plans. Son magnum opus. Le point (presque) terminal de son mythe.
Ran d’Akira Kurosawa, 2h42, avec Tatsuya Nakadai, Masayuki Yui, Mieko Harada – Sorti au cinéma le 20 septembre 1985