Pleasure de Ninja Thyberg, bien que loin de revêtir une allure suggestive, se concentre sur l’industrie du cinéma pour adultes. Il se distingue également comme l’une des œuvres les plus sincères et perspicaces jamais créées autour de la thématique du sexe et de la manière dont il contribue à forger de nombreuses structures de pouvoir inéquitables au sein de la société contemporaine.
Nous sommes introduits à Linnéa (Sofia Kappel), une jeune Suédoise de 19 ans, alors qu’elle transite par l’aéroport de Los Angeles, arborant un enthousiasme rafraîchissant, tout en aspirant à se faire un nom dans l’industrie pornographique sous le pseudonyme de Bella Cherry. Malgré son ambition de devenir la prochaine grande star du porno, elle se rend rapidement compte que la réussite ne se résume pas uniquement à son talent et à son zèle.

Dès les premières minutes du film, Thyberg expose avec éloquence sa thèse, marquées par un générique accompagné de grognements et de gémissements superposés, un gros plan dévoilant Bella en train de se préparer, suivie de sa déclaration sans détour affirmant son attrait pour Los Angeles en raison de son “amour pour les ébats charnels”. Pleasure s’engage dans son sujet avec une telle audace et profondeur que les tentatives habituelles d’Hollywood pour traiter du sexe paraissent, en comparaison, d’une timidité et d’une pudibonderie presque comiques.
Cependant, pour être équitable, il est incontestable que l’industrie du porno est un univers sexuel exceptionnellement excentrique, et le film n’a pas besoin de souligner que son fonctionnement tourne autour des désirs masculins. Bien que le film de Thyberg ne se présente pas comme une attaque frontale contre cette industrie, il met en lumière son cœur toxique de manière profondément troublante et directe. Il en résulte un récit alarmant sur la quête de célébrité dans un domaine où la voie la plus rapide pour y parvenir consiste à satisfaire un marché avide de violence et d’abus envers les femmes. Le simple fait d’avoir des préoccupations est un moyen rapide pour les producteurs de vous ignorer, tandis que le fait de se plier à leurs exigences peut signifier la perte de son identité. Les moments d’inconfort de Bella pendant ses tournages sont accueillis avec une bienveillance à peine dissimulée, presque performative, de la part de ses partenaires de scène et de l’équipe. Ils lui assurent “Prends tout le temps dont tu as besoin”, tout en se demandant presque immédiatement si elle peut poursuivre, tout en la qualifiant de femme courageuse qui doit persévérer. Une analyse charitable pourrait qualifier cela de manipulation terrible, menant à une scène déconcertante au milieu du film.

Si il traite principalement de l’industrie du porno, il offre également de précieuses réflexions sur la place des femmes sur le lieu de travail, une problématique qui trouve des échos dans presque tous les secteurs professionnels, tant le sexisme est ancré dans la culture du travail depuis des siècles. Cependant, malgré tous ces éléments, il serait inexact de qualifier le film de négatif sur le plan sexuel, même si nous avons peu d’informations, apparemment intentionnelles, sur la vie sexuelle non pornographique de Linnéa. Pleasure ne se réduit pas à une lamentation sombre concernant les femmes entraînées dans l’abîme sans âme de l’industrie. De nombreuses interactions de Bella avec ses collègues actrices sont empreintes d’une chaleur et d’un humour réconfortants, en particulier son amitié inattendue et touchante avec Joy (Revika Anne Reustle), une actrice plus expérimentée.
La réalisation de Thyberg se caractérise par l’absence presque totale d’images explicitement séduisantes, à la manière du film Shame de Steve McQueen. Elle emploie des angles peu flatteurs, un éclairage cru et un montage discordant pour créer une atmosphère totalement différente. Cette approche atteint son apogée lors du voyage de Bella à une exposition à Las Vegas, où l’attention se porte moins sur le défilé de corps parfaits que sur la multitude d’hommes bavant devant la caméra.
Le passage de Bella, qui accueille joyeusement les visiteurs de l’exposition, aux larmes devant un miroir, est si réaliste qu’il est facile d’oublier que Sofia Kappel, contrairement à la plupart des acteurs, n’est pas une véritable actrice pornographique. Il offre une performance d’une audace et d’un courage quasi impossibles, apportant une crédibilité émotionnelle remarquable à son personnage. Pleasure se révèle comme un portrait aussi troublant que sincère de l’industrie pornographique contemporaine. Dans ce premier film inoubliable, Sofia Kappel se révèle tout simplement hypnotique.
Pleasure de Ninja Thyberg, 1h49, avec Sofia Kappel, Revika Reustle, Evelyn Claire – Au cinéma le 20 octobre 2021
-
Louan Nivesse8/10 Magnifique
-
Louis Debaque9/10 ExceptionnelPercutant, hypnotique, brutal, envoûtant, charmant et audacieux, Ninja Thyberg réalise un portrait saisissant de l'industrie pornographique. Il nous dévoile l'envers du décor de ce monde secret, rempli de préjugés. Bien que le film puisse sembler provocant par sa franchise, il sert à nous préparer et à nous expliquer que nous allons explorer ce monde sans vulgarité. Les corps sont filmés avec respect, et les scènes intimes sont traitées avec pudeur. L'ensemble est porté par des acteurs convaincants, dont la profondeur de jeu nous plonge dans un univers méconnu, celui de l'humain. Les acteurs et leurs performances laissent place à la psychologie des personnages, au détriment de la simple mise en scène. Le film se veut factuel, mais non simpliste. Il peut par moments être dérangeant et choquant, en particulier lors de ses scènes les plus crues, mais il atteint une puissante efficacité émotionnelle et suscite l'empathie à d'autres moments. "Pleasure" est un film intense, sincère, éprouvant, mais empreint de tendresse et de bienveillance. C'est comme une série de sensations fortes, alternant entre la claque brutale, la caresse délicate, et le baiser déposé avec douceur. Un grand film qui ne laisse pas indifférent.


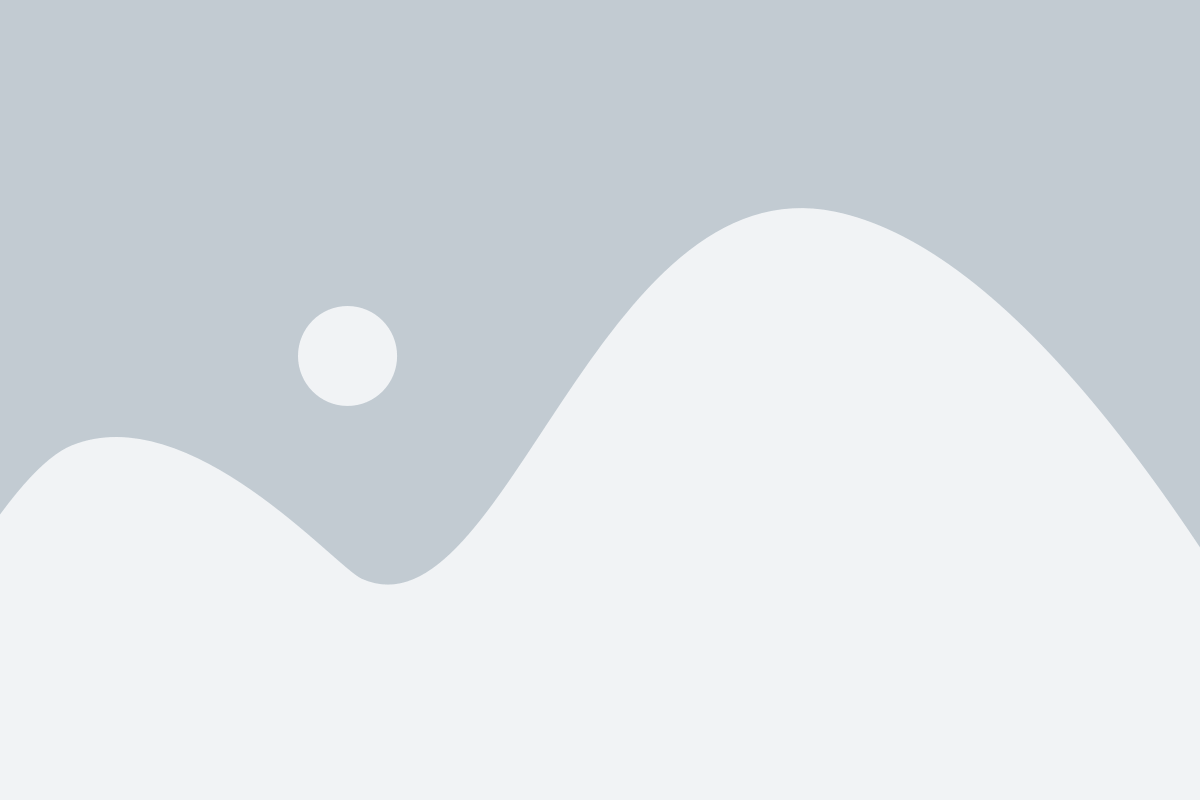







Un Ping
Pingback: [CRITIQUE] Je ne suis pas un héros - Faut pas croire ce que disent les journaux - C'est quoi le cinéma ?