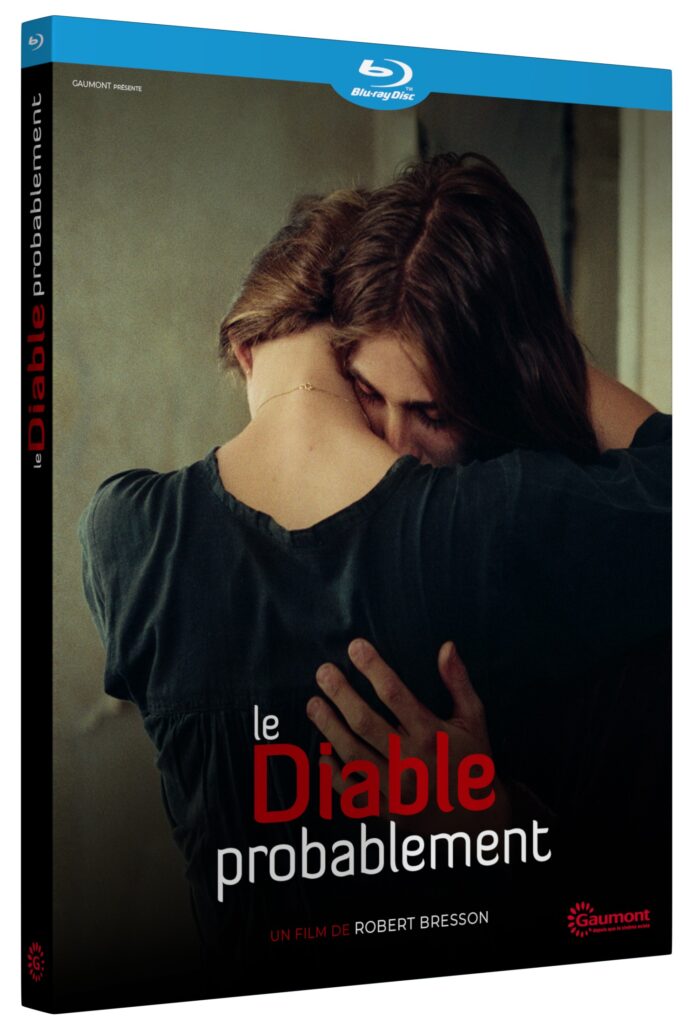Critique | Le Diable probablement de Robert Bresson | 1h40 | Par William Carlier
Robert Bresson disait à propos du Diable probablement qu’il souhaitait retranscrire « une civilisation de masse où bientôt l’individu n’existera plus ». Son cinéma prend soin des vaincus ; il leur donne une humanité propre avant la condamnation fatale. Dans ce film, un étudiant parvient à se faire tuer pour ne plus avoir à subir les dégâts de l’individualisme, la destruction de toute notion d’écologie. Son groupe d’amis, très investi dans la lutte pour l’environnement, proteste à l’église et contre le capitalisme. Mais lui se retire, observant à distance ceux qu’il pense aimer, et qui l’aiment. Ceux qui s’engagent. Ce récit d’adolescence ne pouvait que convenir au réalisateur, développant au fil de ses œuvres la déréliction des hommes en société, perdant foi en leur parcours de vie et en l’humanité. Le diable probablement est une fin de phrase prononcée par un personnage avant l’irruption d’un accident de circulation en bus, ne sachant pas comment justifier autrement ce qui survient. Faut-il donner une cause à toutes ces injustices, à tout ce malheur du monde ? La mise en scène éclaire les sujets, jamais les causes, parce qu’il n’y a pas de meilleure manière d’illustrer une situation de péril qu’en ne révélant pas toute l’ampleur des circonstances. Alberte, Hedwige et Michel voulaient s’occuper de Charles, mais rien n’a pu empêcher l’acte irréparable. Marchandant son désir de mourir, il s’est fait tuer.

© Gaumont – Tous droits réservés.
Les images télévisées évoquent la disparition de la faune et de la flore. Charles regarde un poste une dernière fois avant sa mort. Rien ne change avant son départ. Des arbres s’écroulent férocement. Charles tire dans l’eau pendant qu’Alberte s’enfonce dans son chagrin, seule dans son lit. La représentation de la jeunesse n’est pas édulcorée, car chacun pense à son petit bonheur, à la meilleure manière de supporter la vie — ou de la surpasser. L’individualisme revient très souvent dans le cinéma de Bresson, et il consiste ici en une série de paradoxes. Des réactions contraires naissent quand l’un décide enfin d’agir en fonction de l’autre. Le marxisme prononcé des personnages se confronte à la recherche du plaisir de consommation malgré tout : canettes de sodas laissées au sol, vol à l’église, emprisonnement, tout accentue l’enfermement du personnage dans son propre malheur. « Fin de civilisation, mais croissance ; ayez la foi », dit le prêtre. Les yeux de ces jeunes font peine à voir, et Charles ne sait plus où se situer, quelle décision prendre, quoi penser. S’agit-il même de penser ? Idéaliste, il fait des promesses aux filles mais se désengage aussitôt ; souhaite acheter l’arme mais tente de se tuer avant d’en donner l’argent. Inconstant et imprévisible comme les dégradations contemporaines de toutes sortes, il incarne cette blessure générationnelle dans un entre-deux qui n’avance pas, mais se consume de l’intérieur.
L’angoisse dépassionne les relations. Mais ne pas s’angoisser reviendrait à ne rien faire et à rester aveugle. Cette bande de petits prophètes combat avec vigueur, mais l’utilité de leurs actions est immatérielle, peu concrète, ignorée ou exploitée par d’autres. Comme Dieu, Charles ne se sent plus intégré à ces combats. Il veut retrouver sa soif de jeunesse, lutter sans se raccrocher au groupe. Profiter de la vie sans avoir à rendre de comptes. Le désordre individuel d’un adolescent et une civilisation morte à ses côtés, se mouvant sans se comprendre. La ville de Paris n’est jamais aussi vivante que la nuit, dans l’obscurité. L’austérité graphique caractérise le refus du rapport affectif facile à l’œuvre, Bresson se plaisant à mettre en scène la désincarnation et l’irrévérence du commun des mortels, comme souvent. Ces jeunes transcendent leur humanité dans le spleen, se heurtant les uns aux autres pour un mal que l’on a rendu visible… et invisible. Probablement par le diable.
| Sorti le 15 juin 1977